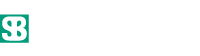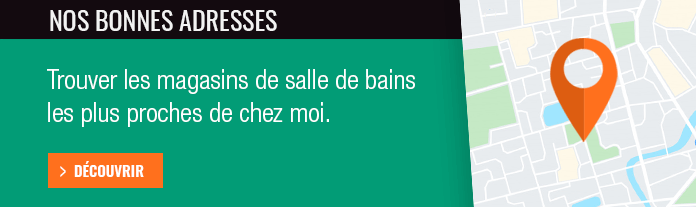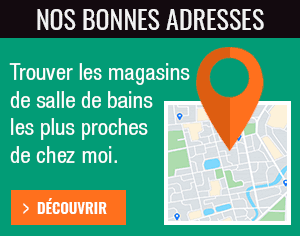La première décennie du XXIe siècle se cale parfaitement dans le sillage des années 1990 du précédent. Les techniques majeures sont en place, le design maintient son exubérance et sa nécessité, et le contexte commercial confirme les tendances existantes.
En ce début de siècle, la concurrence mondialisée comprime de plus en plus les prix. En entrée de gamme, un mitigeur est accessible à partir de 100 francs (15 euros)… Ces prix bas, qui cachent souvent des composants de qualité médiocre, ont des effets pervers : ils dévalorisent le produit, perturbent la perception d’un consommateur qui ne peut comprendre la légitimité d’écarts aussi énormes entre les différentes gammes. Photo ci-dessus : mitigeur cascade Massaud, Axor.

Une conception écologique de la fabrication de la robinetterie sanitaire
L’acier inox poli, d’aspect, est déjà considéré comme meilleur du point de vue de l’environnement, parce qu’il permet d’éviter l’opération de chromage des surfaces, assez polluante. Une étude menée par Hansgrohe/Axor pour comparer l’utilisation du matériau traditionnel, le laiton, avec celle de l’acier inox brossé, met alors en évidence une réduction de l’ordre de 50 % des incidences sur l’environnement des phases de fabrication.
Cet avantage écologique résulte de l’économie des matériaux utilisés, de l’énergie et d’un gain réel en matière d’eutrophisation des nappes phréatiques et des cours d’eau. Se trouvaient également conciliés ces avantages avec les économies d’eau. Un fabricant réputé pour la qualité de son design (Vola) utilisa pour un robinet de douche un alliage de cuivre et de métal d’armement, ainsi qu’une cartouche de 28 mm de diamètre.
Le confort sur l’évier
Dans un logement, c’est le robinet d’évier qui est le plus sollicité : 80 manœuvres ou plus par jour ! Il sera donc logiquement soigné et a bénéficié de plusieurs innovations, dont le bec extractible pour en élargir le rayon d’action.
Quelques exemples : les disques céramique sont polis comme un miroir et revêtus d’un lubrifiant spécifique (Grohe), dont une partie est mise en réserve dans des « microchambres » ménagées dans la cartouche, dispositif qui en accroît la longévité. L’extrémité du bec est équipée d’aérateurs efficaces qui déterminent un jet calibré tout en économisant la quantité d’eau utilisée. Dès 2002, Ideal Standard lance Clear Tap. Cette fois, il s’agit d’économiser les bouteilles d’eau en plastique, l’eau courante ayant parfois mauvais goût (ajout de chlore) et, plus rarement, suspectée de comporter des traces de plomb. Clear Tap, équipé d’un filtre indépendant, délivre une eau (froide) dépourvue de ces composants. L’électronique intervient en indiquant le niveau du filtre par un affichage digital discret, en partie haute du bec.
L’électronique devient… lumineuse !

Un autre aspect des technologies modernes apparaît sur les robinetteries, déjà bénéficiaires des LEDS et de l’affichage digital : la fibre optique. Celle-ci apporte la lumière et… la couleur. Ainsi, en 2002, Hansa lance un mitigeur (lavabo) au design surprenant, Hansa Canyon (photo ci-dessus), singularisé par un bec rectiligne mais creusé sur sa partie finale, faisant apparaître l’eau délivrée illuminée et colorée par la fibre optique.
Cette technologie autorise l’usage de plusieurs couleurs. Elle seront utilisées à divers propos. Tout d’abord pour visualiser la température de l’eau : bleue quand elle est froide, et passant au rouge quand elle est chaude. Ensuite, pour l’agrément et ce qu’on nomme improprement « chromothérapie ». C’est-à-dire l’effet psychologique des couleurs et de leurs propriétés sur l’organisme. Des applications concernant essentiellement le bain (balnéo ou hydromassage) et la douche, avec des résultats confirmés… à condition d’y croire.
Les directions du design

→ le minimalisme : courant majoritaire initié après le lancement de la ligne Starck qui en est l’archétype, il recherche une simplicité géométrique maximale, dont les lignes épurées empruntent à la courbe plus souvent qu’à la ligne droite,

→ l’industriel : la récupération d’objets ayant appartenu à l’univers de l’usine ou de l’atelier est ici utilisée plus pour l’originalité que pour l’esthétique,
→ le rétro : il ne s’agit plus d’inventer une forme, mais de répliquer avec exactitude des modèles appartenant en majorité aux années 1900 ou 1930, mais dotés des innovations techniques les plus récentes,
→ l’intemporel : c’est un compromis entre le rétro et l’actuel, soit un rappel très léger d’une ligne ancienne, soit un design contemporain modéré, presque « classique ». L’objectif est d’échapper aux effets de mode, autorisant une commercialisation durable.
La conception de la douche évolue

La robinetterie de douche accompagne ces changements. Si l’élément principal, le thermostatique (devenu indispensable), est parfaitement au point, il va recevoir l’apport de l’électronique et des performances de ses prolongements, à savoir la douchette manuelle et la pomme de tête fixe qui vont prendre des dimensions et des capacités inédites.
Un exemple : en 2000, le fabricant germanique Dornbracht lance Rain Sky (Ciel de Pluie). Cet ensemble se compose d’un large module en acier, carré ou rectangulaire, installé à fleur de plafond, dont les jets multiples sont commandés par un thermostatique mural encastré à touches digitales. Cette commande permet de disposer au choix de 3 jets pluie (large ou concentré) éclairés, et d’une fonction « brumisation ». Un must.
La douchette à main : un complexe technique
L’ergonomie intervient dès sa conception pour définir le meilleur angle reliant la poignée à la pomme de douche, et l’optimalité des conduites intérieure, du nombre d’orifices et de leur position. Les matériaux utilisés composent une « barrière thermique » entre l’eau chaude et la surface, pour le confort d’utilisation. Les orifices apparents ou buses bénéficient d’un silicone bicomposant, ce qui permet, d’un coup de chiffon, d’éliminer les dépôts de tartre.
L’intérieur du pommeau est une minuscule usine produisant cinq jets différents :
→ normal (ou pluie) utilisant la totalité des buses (de 18 à plus de 72…) ;
→ soft (ou perlant) obtenu par une chambre de mélange ou l’eau est « cassée » et enrichie d’air ;
→ massage (puissant et pulsant) produit dans les chambres d’un rotor où l’eau est comprimée puis expulsée par intervalles ;
→ turbo (puissant et concentré) délivré par une ouverture centrale plus large ;
→ caresse (jet doux en spirale) obtenu au moyen d’une roue de turbine dont les canaux s’ouvrent et se ferment alternativement.
Toutes les douchettes à main ne disposent pas de cinq jets, mais on mesure ici la remarquable avancée technique du produit, dont les prix restent abordables.
Réduire, agrandir, élargir, économiser, singulariser…
Pour affiner les lignes des robinetteries, la taille des cartouches céramique se réduit à un diamètre de 28 mm, et même 25 mm. Il serait possible de faire moins, mais il faut tenir compte de la tuyauterie interne.

A l’inverse, dans la douche, les pommes de tête, dans le but de simuler une pluie tropicale, acquièrent des dimensions inusitées avec des diamètres de 40 ou 60 cm, et plus encore, accueillant plus de 250, voire 350 buses. Si ces pluies « tropicales » le sont un peu trop pour économiser l’eau, il convient de relativiser leur diffusion, qui demeure restreinte. Au contraire, nombre d’améliorations contribuent aux économies d’eau. La conception des cartouches intervient (butée d’ouverture de débit, par exemple), mais ce sont les aérateurs qui, en bout de bec, limitent véritablement le débit. Ainsi, avec le Waterdimmer, Hansgrohe enrichit l’eau d’une quantité d’air optimale pour obtenir un débit constant de 7,2 litres/minute seulement au lieu des 12 à 15 litres/min d’alors.
Des apports technologiques précis
Après les avancées fondamentales du XXe siècle, qui font de la robinetterie un symbole de la modernité des équipements domestiques et de l’hygiène, les innovations qui suivent, pour ne concerner que des détails, n’en appartiennent pas moins à la haute technologie.
Avec l’emploi de l’acier, les finitions font l’objet de recherches et de soins particuliers pour dépasser le classique chromage brillant, et aller vers d’autres effets visuels.
La marque Axor/Hansgrohe utilise ainsi (en 2006) le procédé PVD ou « Physical Vapor Deposit ». La couche métallique, très fine – un micron maximum – est appliquée dans une enceinte sous vide où une vapeur métallique est produite à l’aide d’un arc électrique et d’une plaque du métal à appliquer. Ce procédé assure un revêtement parfait, plus résistant, quelle que soit la base : acier inox ou chrome.
Dans un autre domaine, celui de l’hygiène, ce même fabricant lance le premier flexible de douche antibactérien. A savoir, la combinaison d’un nouveau plastique avec un mélange de verre céramique et d’ions d’argent, ces derniers étant réputés pour leur pouvoir antibactérien. Cette combinaison inédite agit autant à l’intérieur qu’à l’extérieur du flexible.
| « Précédent |
SOMMAIRE DE L'ARTICLE
-
Histoire de la robinetterie sanitaire, des origines à nos jours
-
Histoire de la robinetterie, épisode 1 : des origines à l’Antiquité
-
Histoire de la robinetterie, épisode 2 : le Moyen Âge et la Renaissance
-
Histoire de la robinetterie, épisode 3 : les XVIIe et XVIIIe siècles
-
Histoire de la robinetterie, épisode 4 : le XIXe siècle, de la Révolution au préfet Rambuteau
-
Histoire de la robinetterie, épisode 5 : avec Belgrand, les robinets sont enfin alimentés
-
Histoire de la robinetterie, épisode 6 : l’entre-deux-guerres et l’arrivée du robinet temporisé
-
Histoire de la robinetterie, épisode 7 : l’après-guerre et les Trente Glorieuses
-
Histoire de la robinetterie sanitaire, épisode 8 : la monocommande et les années 1970-80
-
Histoire de la robinetterie, épisode 9 : les années 1990, sous le signe du design
Histoire de la robinetterie sanitaire en France, épisode 10 : les années 2000-2010