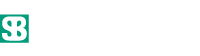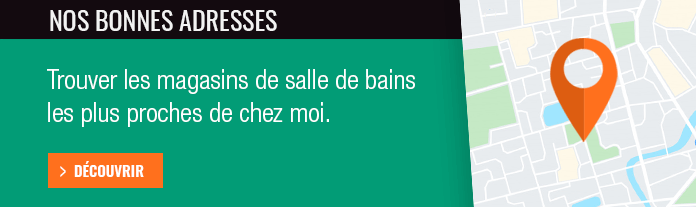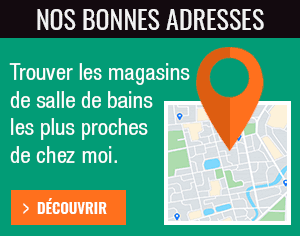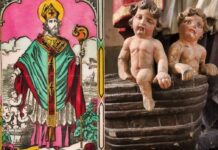Après le bain de vapeur ou les exercices athlétiques, grecs et romains se raclaient le corps avec un instrument rigide tombé en désuétude : le strigile. Les lignes en S de ce « gant de fer » étaient si célèbres en leur temps qu’elles ont même inspiré un motif décoratif !

Utilisé après l’effort par les athlètes au gymnase et à la palestre (le centre d’entraînement de l’époque), mais aussi dans les thermes, le strigile est un ustensile de toilette. Une toilette qui, dans les sociétés grecques, romaines et étrusques, diffère sensiblement de la nôtre… Car si les complexes antiques conçus pour se détendre et se baigner sont bien les ancêtres de nos spas, l’utilisation de cet instrument en forme de faucille fait nettement moins rêver ! Explicite, son nom vient d’ailleurs du latin stringere, qui veut dire tout à la fois étreindre, serrer, cueillir en pinçant, raser… Il a donné strigilis, racloir, ainsi que strigila, racloir pour se laver, étrille.
Photo ci-dessus : Strigile en bronze de 21 cm de long doté d’un manche à ressort sur lequel est inscrit le nom de son propriétaire (Agemachos), 1er siècle avant J.-C./1er siècle après J.-C., MET, New York – Trois jeunes athlètes se nettoient après l’entraînement, l’un avec un strigile, les autres avec de l’eau provenant d’un bassin, peinture à figures rouges sur un cratère à colonnes attique, vers 500-450 avant J.-C., musée archéologique, Bari (Wikimedia Commons) – Jeune homme se nettoyant avec un strigile, peint sur un kylix attique du peintre d’Érétrie, vers 425 avant J.-C., musée national étrusque, Rome (Wikimedia Commons).
Le strigile, un ustensile de la toilette antique

L’objet était manipulé par l’athlète ou le baigneur, parfois entre camarades (difficile de frotter son propre dos) ou encore par un esclave voué aux ablutions de sa riche matrone… Les hommes – mais aussi les femmes (aux établissements de bains, voire dans la sphère privée pour les plus fortunées qui disposaient de leurs propres thermes) –, l’employaient pour racler la transpiration, l’huile de massage dont le corps était enduit au sortir des étuves et la crasse incrustée sur la peau lors des activités sportives réservées à la gent masculine, en particulier la lutte. Celle-ci se déroulait en plein air, et il n’était pas rare que les athlètes s’enduisent de sable pour faire écran aux coups de soleil… et entraver les prises de l’adversaire.
A l’entrée des bains publics, des tapis de mosaïques invitaient à se servir de cet objet, un peu comme les pancartes des piscines actuelles rappellent l’obligation du port du bonnet et des sandales de bain.
Ci-dessus : Statuette d’un athlète se raclant la cuisse, musée national étrusque, Rome – Trois strigiles entourant une paire de tongs romaines, mosaïque du sol des bains romains de Sabratha, Libye (Wikimedia Commons) – Jeune homme se raclant le bras à l’aide d’un strigile tandis qu’un autre lui frotte la nuque, fragment en terre cuite d’un kylix grec du 2e quart du Ve siècle avant J.-C, MET, New York – Ephèbe tenant un strigile, sur une stèle funéraire d’Euphéros, vers 420 avant J.-C., musée archéologique du Céramique, Athènes (Wikimedia Commons).
Un élément de base du nécessaire de toilette de l’époque
Peintes sur des vases, de nombreuses scènes témoignent de la fonction du strigile et du contexte de son utilisation, de même que de plus rares sculptures qui détaillent la gestuelle de l’athlète et des petits objets d’art. Central dans la culture antique, le thème décoratif de l’athlète armé d’un strigile fut longtemps très à la mode !
Des trousseaux comptant plusieurs strigiles, sur le modèle de ceux que nous connaissons pour les clés, permettaient de disposer d’un jeu d’outils de tailles ou d’utilisations variées. Ils étaient souvent reliés par une chaîne à un petit vase. De type aryballe et parfois appelé ampulla, celui-ci contenait une huile qui avait sans doute pour effet d’adoucir le passage du racloir métallique sur la peau.
Ci-dessus : Paire de strigiles sur un anneau, en argent, milieu du 1er siècle avant J.-C., MET, New York – Set de quatre strigiles en bronze et anneau de transport, 1er siècle avant J.-C./2e siècle après J.-C., MET, New York – Set de strigiles reliés par un anneau à boucle moulée en forme de tête canine, flacon copie d’un modèle romain découvert à Pompéi, 199 avant J.-C. à 500 après J.-C. (Wellcome, Wikimedia Commons) – Statue d’Apoximenos, marbre, copie romaine 1er siècle après J.-C. d’après un original grec en bronze de Lysippe vers 320 avant J.-C., musée du Vatican, Rome (Wellcome, Wikimedia Commons).
Une crasse qui valait de l’or
C’est difficile à imaginer, mais pourtant vrai, étayé par des recherches historiques [1]. L’huile d’olive mêlée de peaux mortes, silice et autres saletés que les strigiles servaient à évacuer était autrefois un déchet aussi précieux que visqueux. Un commerce pseudo-médical valorisait cette onction de poussière et de sébum, censée agir contre les courbatures, les entorses, les rhumatismes… Ce remède se prescrivait également en gynécologie pour soulager par exemple les inflammations et les contractions de l’utérus !
Appelée gloios (strigimentum en latin), ladite mixture était vendue dans des flacons, après collecte à même le sol ou directement sur la peau, par des esclaves. Si l’on en croit Pline L’Ancien [2], en échange de ses services, le gardien chargé de l’entretien du gymnase (palaistrophylax) ne se gênait pas pour tirer profit de cette huile de massage de seconde main, enrichie en raclures corporelles de toutes sortes : « Les Grecs, ces pères de tous les vices, en ont abusé en le faisant servir au luxe et en l’employant communément dans les gymnases : en effet, c’est un fait bien connu que les directeurs de ces établissements ont vendu les rognures de l’huile qui y était employée pour une somme de quatre-vingt mille sesterces. »
Des trésors de la vie quotidienne conservés dans les musées

Ci-dessus : Strigile en bronze dont l’anneau présente un décor moulé (Héraclès luttant contre un lion), 1er-2e siècle après J.-C., musée archéologique national d’Athènes (Wikimedia Commons) – Strigile retrouvé dans un cercueil à Palestrina et dont le manche représente une femme tenant un strigile contre sa hanche (H 40,64 cm), vers 300 avant J.-C., British Museum (Wikimedia Commons) – Bague scaraboïde grecque avec scène d’athlète maniant un strigile orné d’une tête de canard à l’extrémité, attribué à Epimène, vers 500 avant J.-C., musée Getty – Copie d’un ensemble de deux strigiles romaines, Europe, 1880-1920 d’après un original datant de 200 avant J.-C. à 200 après. J.-C., Science Museum (Wellcome, Wikimedia Commons).
Un accessoire populaire pour faire sa toilette, jusque dans la mort

Ce racloir omniprésent à l’époque est devenu, par extension, un motif en trois dimensions, particulièrement populaire dans la seconde moitié du IIe siècle et au IIIe siècle après J.-C. Avec ses cannelures en forme de S, le décor « à strigiles » était surtout utilisé dans la décoration des sarcophages antiques, mais aussi sur de grands vases en marbre souvent associés au culte des morts.
Ci-dessus : Zoom sur un décor à strigiles – Vase strigilé à anses serpent (H 44 cm), romain, en marbre, 2e moitié du 2e siècle après J.-C., MET, New York – Sarcophage strigilé, en marbre, vers 220 après J.-C., MET, New York.
L’ancêtre du couteau de chaleur pour chevaux ?
Disparu aujourd’hui, le strigile perdure dans un usage que les hommes de l’Antiquité partageaient autrefois avec leurs… montures. En effet, dans sa destination comme dans sa physionomie, l’instrument se rapproche fortement de l’étrille qui sert toujours à accélérer le séchage des chevaux après leur douche : une fois l’équidé passé sous le jet (afin de le rafraîchir à l’issue d’une séance de travail lorsque les températures sont élevées ou pour le nettoyer…), le cavalier évacue l’excédent d’eau, la crasse et la sueur logées sous le poil de l’animal à l’aide d’un racloir nommé couteau de chaleur.
[1] Alain Cabello-Mosnier, Gloiois, huile et crasse d’athlètes au service d’un massage entre gymnasiarchie et Egypte ancienne, Centre Français de Documentation et de Recherches sur les Massages, qui cite notamment les travaux de Jean-Pierre Brun ainsi que ceux de Jeanne et Louis Robert sur le sujet. Le blog Ancient Anatomies cite quant à lui les recherches de David Potter (The Victor’s Crown : A History of Ancient Sport from Homer to Byzantium) et de Nigel M. Kennel (Most necessary for the bodies of men: olive oil and its by-products in the later Greek Gymnasium, 2001).
[2] Pline l’Ancien, Naturalis historia, encyclopédie en 10 volumes et 37 livres, 1er siècle après J.-C.
[3] Mallet Franck, Pilon Fabien. Le strigile en Gaule, objet utilitaire et vecteur de romanité : l’exemple du strigile de la villa des Champs-de-Choisy à Charny (Seine-et-Marne). In : Gallia, tome 66, fascicule 2, 2009. Archéologie de la France antique, pages 113-151.